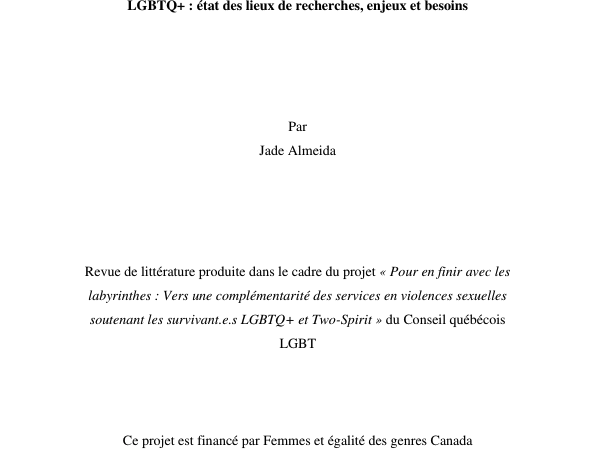La presse lesbienne- “LesbOccidentées”

Je repartage ici un chapitre d’ouvrage que j’avais rédigé pour un projet à paraitre en 2024 sur l’impensé racial de la construction politique du sujet lesbien à Paris dans les années 80-90. Pour des raisons personnelles, je n’ai pas pu continuer le processus jusqu’à publication, mais puisque le chapitre était fait, et qu’il dormait dans mon drive : autant le publier ici.
En 2021, j’ai terminé et soutenu une thèse en sociologie sur les femmes noires qui aiment les femmes et leur résistance aux rapports de pouvoir enchevêtrés. Ma thèse tend à démontrer qu’en se concentrant sur les pratiques et discours d’individus en situation de marginalisation, on peut raffiner notre compréhension de la manière dont se déploient les rapports de pouvoirs qu’iels subissent. Également être témoins d’un engagement innovant envers ces mêmes rapports de pouvoir. Ancrée dans les travaux et pratiques des féministes noires, avec un apport de l’approche queer, il me tenait à cœur de m’éloigner des études centrées sur le trauma pour plutôt me concentrer sur le désir (Tuck, 2009) et les espaces des possibles : possible résistance, possible changement, possible joie. Bien sûr, comme bien d’autres doctorant.e.s avant moi, le texte final de ma thèse était très loin du projet initial débuté il y a 5 ans. À l’époque, ma proposition de recherche était centrée sur la presse lesbienne québécoise : je souhaitais faire une analyse de ces productions médiatiques au prisme de l’intersectionnalité. Ce qui m’intéressait était d’examiner tout particulièrement le cas des lesbiennes afrodescendant au sein de la presse lesbienne québécoise. Cette problématique s’était imposée suite à mon travail de recherche sur Lesbia Magazine, une revue pilier dans l’histoire de la communauté lesbienne en France. Mon analyse avait notamment abordé l’enjeu de la représentation des femmes racisées au sein du périodique, ou plutôt leur absence de représentation, dans une publication qui voulait pourtant s’adresser à toutes les lesbiennes. Ce qui m’avait amené à interroger l’impensé racial de la construction politique du sujet lesbien.
Claudie Lesselier, dans son essai paru dans le numéro 89 de Lesbia Magazine, argumente que l’action des groupes militants lesbiennes s’organise autour de trois axes : “se nommer, se visibiliser, se définir” (Lesselier, 1990, p.13). L’action de « se nommer » se retrouve autour du rejet ou de la réappropriation de mots stigmatisants tels que « gouines » et « goudous ». Ainsi que l’emploi du mot « lesbienne » qui prend le pas sur « homosexuelle » notamment. “Se visibiliser”, est une intervention à plusieurs niveaux : celui de se rendre visible au sein de l’espace public, mais aussi au sein du panorama médiatique français à travers le développement d’une presse spécialisée. Il s’agit également de “se rendre” visible en tant que lesbienne aux autres lesbiennes et briser ainsi l’isolement. Enfin, “se définir” marque le besoin de contrôle de la narration par et sur les lesbiennes. À la fois, face à la société hétéronormative et patriarcale, mais aussi face aux autres espaces de lutte militantes. Or dans le fait de “se nommer, se visibiliser, se définir” un silence et une invisibilisation constants entourent la dimension raciale. La lesbienne se veut sans race, uniquement reconnaissable par son genre et sa sexualité. Par conséquent, sa subjectivité se construit dans l’illusion d’un vacuum racial qui nécessite à la fois d’ignorer entièrement l’enjeu et, simultanément, de participer à son essentialisation. Une dynamique que je me propose d’analyser au sein de la revue Lesbia Magazine. Ce chapitre s’appuie ainsi sur l’analyse approfondie de 5 années clefs[1] de la revue qui marquent son évolution d’un feuillet en noir et blanc tiré à 500 exemplaires, à une revue couleur distribuée à plus de 10 000 exemplaires, jusqu’à son déclin et son arrêt définitif en 2012.
Une presse spécialisée à bien des niveaux
Lesbia Magazine était une revue mensuelle ainsi que bénévole, réalisée par et pour les lesbiennes et distribuée dans toute la France, y compris dans les départements d’outre-mer. Comme mentionné précédemment, elle devient un pilier dans l’histoire de la communauté lesbienne par bien des aspects, notamment du fait de sa longévité : près de 30 ans de publication à raison d’un numéro par mois, à l’exception des mois d’été où un seul numéro est publié pour couvrir la période estivale. Elle est d’ailleurs la seule revue militante lesbienne à survivre à l’émulation de publications des années 70-80. Le tout, encore une fois, alors qu’elle est réalisée de manière bénévole et majoritairement par des femmes qui n’appartiennent pas au monde journalistique. Sa longévité est d’autant plus exceptionnelle que Lesbia Magazine ne souffre d’aucune concurrence pendant près de 20 ans. En effet, aucune autre publication régulière n’est faite à destination de la communauté lesbienne jusqu’au début des années 2000. Son hégémonie médiatique n’est finalement rompue qu’en 2003 avec l’arrivée dans les kiosques de La Dixième Muse. Dans ce contexte, Lesbia Magazine est un cas d’études particulièrement intéressant : à la fois en tant que vitrine de l’histoire de la communauté lesbienne, mais également comme un potentiel vecteur de création communautaire et (re)producteur de normes identitaire.
La presse lesbienne participe à la création d’un espace discursif dans un contexte médiatique marqué par leur invisibilisation, voire la déformation des réalités lesbiennes (Ciasullo, 2001 ; Goyette, 2014). La revendication même de son existence contribue donc à la politisation du privé et à une critique du système dominant. De plus, elle sert de mise en relation entre les individus : elle a pour vocation de briser l’isolement (Laroche, 2009). Une mission particulièrement importante pour les rédactrices de Lesbia Magazine,comme le souligne Catherine Gonnard, rédactrice en chef de 1989 à 1995 : “on était que des passeuses de liens entre deux lesbiennes”[2]. Une présentation à remettre dans le contexte bien spécifique d’une communauté qui n’a pas encore massivement accès aux technologies du numérique et toutes les opportunités de contact qui vont en découler : forums, réseaux sociaux, applications de rencontres, sites spécialisés, etc. Lesbia Magazine propose donc de combler un vide et son arrivée est célébrée au sein de la revue : « Deux femmes ont pris l’initiative de créer LESBIA en juin dernier, pour briser l’isolement et servir de lien de correspondance entre toutes les lesbiennes.[3] » En ce sens, la rubrique des petites annonces est un outil de socialisation particulièrement important au sein de Lesbia Magazine (Almeida, 2015). Cette rubrique devient même une caractéristique centrale de l’identité de la revue, celle à laquelle “on ne touche pas” pour reprendre les mots de Jacqueline Pasquier (2008, 0 :44 min). Mais les rédactrices organisent également des soirées, des évènements de rencontre, promeuvent des activités à destination des lesbiennes et participent à des séjours en groupe. La revue a donc un rôle important pour la vie sociale et culturelle de leurs lectrices, mais également pour son autonomisation politique. Elle favorise la constitution du lien communautaire par l’élaboration d’une identité commune (Eribon, 2012).
La persistance du modèle féministe
Lesbia Magazine voit le jour dans une période foisonnante de la lutte pour les droits des femmes. Depuis les années 1970, on assiste en effet à une multiplication de la presse féministe, qui découle de la multiplication des mouvements de luttes. Si le public lesbien fait initialement partie de ces mouvements féministes, leur marginalisation, ainsi que les débats autour de la politisation ou non du lesbianisme, jusqu’à l’absence de critique de l’hétéronormativité, poussent nombre d’entre elles à en claquer la porte. Leurs vécus sont ignorés et, par conséquent, les luttes d’émancipation tendent à se focaliser sur les besoins des femmes majoritaires, soit les femmes hétérosexuelles (Bonnet, 1998). La compréhension des rapports d’oppressions par l’angle unique du patriarcat participe en effet à leur invisibilisation. Les années 70-80 sont donc une période de tentative d’émancipation des lesbiennes vis-à-vis des groupes féministes, mais également des groupes gays à qui elles adressent des critiques similaires (Bonnet, 1997) : un milieu de lutte qui non seulement échoue à prendre en compte la spécificité de leurs discriminations, mais refuse de faire face à leurs limites internes. Pour le milieu gay, l’enjeu du sexisme et du patriarcat. L’absence d’intersectionnalité des mouvements de lutte féministes et gays devient finalement un moteur d’autonomisation du sujet politique lesbien. Paradoxalement, le mouvement lesbien se réifie autour d’une identité qui fonctionne également sur un modèle de compréhension des systèmes d’oppression comme rigides et fixes. Ainsi, les critique politiques adressées aux féministes et aux gays, quant à leur absence de compréhension des rapports d’oppression qui dépasse la seule identité soit femme soit homosexuelle, vont également devenir un sujet de tension et de critique au sein du mouvement lesbien.
Lesbia Magazine naît donc dans un contexte de réponse et de critique à la presse féministe, en extension des tensions et critiques envers les mouvements féministes. Christiane Jouve publie :
“Faut- il des médias lesbiens ? Dans les circuits mixtes ou féministes, les lesbiennes doivent se contenter des miettes et à quel prix. Prendre la parole, c’est d’abord créer le lieu privilégié ou cette parole s’exprimera librement. C’est aussi assumer l’entière responsabilité de nos choix sans duègues [sic] ni mentors”. (Jouve, 1983, p.22)
Si la volonté d’émancipation est clairement posée, difficile néanmoins pour les rédactrices de complètement éradiquer l’empreinte que le milieu militant féministe a laissée sur leur conscientisation politique. Nombre d’entre elles sont en effet issues de ces groupes militants. Plusieurs éléments indiquent ainsi que le périodique est modelé par l’idéologie féministe des années 1970. Par exemple, le choix de non-mixité de genre qui sera maintenu jusqu’à la fin de la production du magazine[4].
Dès le premier numéro de Lesbia, le comité prend position pour la non-mixité au sein de ce débat. Aucun homme ne peut faire partie du comité de rédaction ou signer d’article et ils ne peuvent pas non plus être le sujet d’articles ou d’interviews. Finalement, les hommes n’apparaissent que dans les cas de dénonciations, lorsqu’un crime contre les femmes a été commis par exemple. En dépit des changements de directions et d’équipe rédactionnelle, la non-mixité n’est jamais remise en cause. Elle est même défendue au sein du mensuel, de manière régulière, vingt ans après le lancement du journal:
“Quant à la non-mixité, traditionnellement les espaces collectifs non mixtes sont masculins. La non-mixité masculine est l’un des fondements de la puissance des hommes, la condition de la transmission sans partage de leur savoir et de leur pouvoir et n’est jamais mise en question par celles et ceux qui questionnent avec véhémence la non-mixité des femmes !” [5]
Les racines idéologiques se retrouvent également en termes de valeur. Prenons l’exemple de l’édito du tout premier numéro qui présente la revue à son lectorat : “L’enjeu est grand : au fil des numéros, LESBIA devra apporter une nouvelle preuve de la force et des compétences des femmes, ce qui implique le contournement de nombreux obstacles, à commencer par l’assistance masculine.” On y parle de reconnaître les compétences « des femmes » et non des lesbiennes. Le mot « lesbienne » n’apparait d’ailleurs qu’à la toute fin de l’édito, ce qui est étonnant pour un mensuel qui revendique de représenter « la » lesbienne. Enfin, les liens étroits avec les racines féministes se retrouvent également en termes de public ciblé. Lors d’une conférence donnée à l’Université de Lyon en 2003, Hélène de Monferrand, rédactrice à Lesbia Magazine depuis 1991, déclare :
“(Notre ligne éditoriale c’est) d’abord les lesbiennes, et ça c’est une sorte de réaction envers les féministes des années 70 qui nous virait. Donc les lesbiennes d’abords, priorité absolue. Seulement comme ça ne suffit pas à faire des sujets, en deuxième on a immédiatement les féministes, les femmes féministes. Et en troisième, le reste des homosexuels donc les gays. Mais quand on lit notre journal, et c’est assez clair, on place les femmes féministes hétéros avant… et bien avant les pédés pour reprendre le vocabulaire utilisé depuis ce matin.” (2008,0 :44 min)
Ses propos établissent une distinction et une hiérarchie très nette entre les lesbiennes et les féministes, de plus les féministes sont associées à l’hétérosexualité, ce qui exclut d’emblée qu’une lesbienne puisse être féministe. Pourtant, si cette présentation catégorique des publics cibles n’est pas directement contredite par Jacqueline Pasquier, cette dernière présente toute de même toutes les rédactrices de Lesbia Magazine comme étant féministes. Et les féministes se maintiennent dans le lectorat souhaité.
La revendication d’autonomisation des lesbiennes, vis-à-vis des féministes, se fait donc de manière paradoxale au sein du magazine. Le floue de la ligne éditoriale illustre les rapports imbriqués et complexes entre luttes féministes et luttes lesbiennes notamment au travers du choix d’organisation de travail, des valeurs politiques de la revue et du contenu du mensuel. Mais je propose que le traitement de l’enjeu racial au sein de la revue soit aussi un résiduel des ramifications féministes de Lesbia Magazine.
Un échec illustré en couleur
Le féminisme français s’est construit autour des expériences de femmes en position majoritaire.
“Si dans les pays anglo-saxons les questions de race ont occupé très tôt le devant de la scène, ce sont les questions de classe qui sont davantage présentes dans le contexte français, cohabitant avec un féminisme universaliste axé principalement sur l’oppression de genre.” (Maillé, 2015, p.170)
Ainsi le modèle féministe matérialiste à la française est un mouvement de lutte qui a historiquement ignoré les enjeux de racisation, les processus coloniaux ou encore tout autre rapport de pouvoir qui pourraient menacer l’homogénéité du “nous femmes”. Dans le milieu militant lesbien, la tendance s’y reproduit : Lesbia Magazine offre à son lectorat un modèle auquel s’identifier à une époque où l’image de l’homosexualité féminine était extrêmement rare, participant de ce fait à la (re)production de normes. Or ce modèle est majoritairement représenté par un corps blanc et porté par la voix de lesbiennes blanches, sans que ce cela ne soit jamais problématisé. L’analyse centrale portée sur la double oppression (par le genre et l’orientation sexuelle) devient un obstacle à la reconnaissance des oppressions vécues par d’autres populations minoritaires, y compris la capacité de reconnaître son propre rôle d’agent et de bénéficiaire des rapports de pouvoir. Michèle Larrouy écrit à ce sujet dans le catalogue Mouvements de Presse : « Le mouvement féministe a mis de nombreuses années à remettre en cause son peu de réflexion sur la non-reconnaissance dans le mouvement des groupes de féministes ou de lesbiennes issues des migrations forcées, ainsi que son racisme intégré.[6] »
Prenons le cas des couvertures qui fonctionnent comme une projection visuelle et un résumé de l’identité du périodique. La jaquette d’un périodique a ceci de particulier qu’elle se renouvelle à chaque nouveau numéro, mais doit tout de même garder une cohérence avec les publications précédentes. Cette unicité permet ainsi au lectorat cible de reconnaître très rapidement le magazine qu’il recherche, tout en lui proposant d’emblée les nouveautés du mois. La couverture doit donc maintenir un équilibre entre les traits immuables (le titre, le logo, le format, la colorimétrie qui marque son identité…) et les traits inédits du mois (le thème du dossier spécial, le modèle de la photographie, les gros titres…). La couverture de Lesbia Magazine a beaucoup évolué entre 1989 et 2012 passant du noir et blanc, à la couleur, du feuillet papier à la couverture glossy, avec changement de nom, de logo et de format au passage. Néanmoins, les codes qui vont marquer son identité visuelle se mettent très vite en place notamment avec une couverture qui met en scène une ou plusieurs femmes. La première année les groupes sont plus nombreux : elles apparaissent en mouvement, joyeuses, tandis que les corps sont très proches, ce qui renvoie l’image de la camaraderie et de la sororité, plutôt que de la sensualité. Les rares couvertures qui esquissent l’idée de relation sexo-affective sont très pudiques : les quelques couples mis en scène sont soit de dos, et se tiennent par la taille, ou alors font face à la caméra, mais maintiennent une posture formelle, éloignant tout soupçon de sexe ou de sensualité.
Si je souligne l’absence d’érotisme ou de sensualité des modèles mis en couverture, il faut toutefois y opposer les photographies des femmes noires. Ainsi, la couverture de juin 1995 met en scène de manière érotique le seul portrait de femme noire réalisé sur toute l’année écoulée. De même, la seule exception du couple, mis en scène de manière sensuelle, reprend la jaquette d’un DVD sur laquelle figurent deux jeunes femmes très féminines, dont les vêtements ainsi que la pose jouent sur la sensualité. Là encore les deux sujets ne sont pas des femmes blanches. Cette association entre érotisme et corps racisé, notamment corps noir, n’est pas anodin dans une revue qui n’est absolument pas caractérisée comme sensuelle et n’offre quasiment jamais de contenu que l’on pourrait qualifier d’érotique. Les articles sur le sexe sont non seulement rares, mais ils se caractérisent par un ton formel. Ils sont informatifs, très souvent en lien avec les maladies sexuellement transmissibles, ou documentaristes lorsque abordent des pratiques traitées comme marginales : soit le B.D.S.M par exemple[7]. D’ailleurs en 1983 est annoncée la création de la rubrique “sexualité” avec une liste de projets d’articles, mais l’idée est abandonnée dès le mois suivant.
L’absence de sexe ou d’érotisme dans une revue crée par et pour une communauté qui s’identifie et créer du lien autour de leur orientation sexuelle peut paraître paradoxal. Pour autant, Michèle Larrouy argumente que ce serait en réponse au détournement de la sexualité lesbienne par le regard pornographique. Selon cette plasticienne et professeure d’arts plastiques, le corps des femmes qui aiment les femmes a déjà été bien trop utilisé à des fins sexuelles pour le regard des hommes pour qu’un groupe de lesbiennes puisse se sentir légitime à publier de l’érotisme. Éviter le contenu trop sexuel c’est à la fois refuser de participer à une économie pornographique dans laquelle leur sexualité est détournée, mais c’est aussi éviter le regard voyeuriste d’un public pour lequel Lesbia Magazine n’est pas destiné. Lesbia Magazine met donc en scène le corps lesbien dans sa “dimension réelle”, pour reprendre les mots de Catherine Gonnard, mais aussi banale. Elles privilégient des modèles bénévoles, intercalées avec des célébrités out, dans une mise en scène somme toute banale : dans un jardin, sous fond de ciel bleu, dans la rue, à la Pride… Si une certaine variété d’âges apparaît ainsi au fil des années, la couverture participe tout de même à offrir un modèle bien précis de “la” lesbienne : principalement issues des mouvements militants, cheveux cours, en pantalon, rarement très féminine, voir plus souvent butch et surtout blanche. Dans ce contexte, il est d’autant plus critique de souligner que les rares occasions où des femmes racisées apparaissent en couverture, elles sont caractérisées par l’érotisme. La position politique de protection face au regard voyeuriste ne semble pas s’étendre aux corps non blancs. Ce que Michèle Larrouy dénonce par la suite : « On constate aussi l’utilisation dite exotique, donc raciste, des corps de femmes non occidentales » (Larrouy, 2009, p.185). Une représentation qui s’ancre dans une longue histoire stéréotypée d’association des femmes noires à une sexualité débridée, animale, pulsionionnelle…en somme : autre (Collins, 1991 ; hooks 1992).
“LesbOccidentées” (Doumia, 2011, p.17)
Non seulement les femmes racisées sont absentes des couvertures, mais elles sont tout aussi peu représentées comme sujet d’interview ou en tant que rédactrices. Pour couronner le tout, dans les rares occasions où le racisme est abordé, les positions du comité de rédaction consistent à étouffer, voire délégitimer les critiques. Citons, par exemple, les interviews accordées à Elula Perrin, directrice de la première boîte de nuit lesbienne a Paris. Cette dernière fut au cœur d’une controverse concernant le refoulement des lesbiennes noires à l’entrée de son établissement. Questionnée à ce sujet, Catherine Gonnard explique avoir en effet été désapprouvée par une partie du lectorat pour avoir accordé des articles à cette femme d’affaires. L’ex-rédactrice considérait toutefois qu’il n’y avait jamais eu de preuves véritables de son racisme, ou du refoulement sur critères raciaux à l’entrée de la boîte de nuit, pour justifier un boycott. Un commentaire à mettre en contexte d’une femme blanche qui ne juge pas les témoignages de personnes concernées comme suffisant en tant que preuve. Et alors qu’un groupe de femmes racisées s’était organisé pour dénoncer le traitement subi.
En effet, en réponse au racisme vécu au sein du milieu lesbien, se forme un nouveau groupe militant à Paris : le Groupe du 6 Novembre. Des lesbiennes dont “l’histoire est liée à l’esclavagisme, les colonisations et l’impérialisme” et qui souhaitent “battre en brèche les constructions limitées et limitantes dont nous pouvons faire l’objet” (Groupe du 6 Novembre, 2001, p.8). C’est une protestation de l’édition de Cineffable en 1999 qui mène à la création du collectif. Ce jour-là elles y apostrophent Elula Perrin, entre autres, et dénoncent la fétichisation qu’elles subissent en affichant des slogans basés sur leurs vécus (Blase, 2019) Jacqueline Pasquier, rédactrice en chef de Lesbia Magazine, en parlera en ses termes :
“une espèce de commando de cinq à six femmes (du grand Sud), a surgi sur le podium de la cafétéria du sous-sol […] L’une d’elles a alors invectivé violemment une des personnes présentes à ma table […] et l’a dénoncée comme une personne à virer et à laquelle on devait faire la peau car elle pratiquait dans sa boîte de nuit parisienne le délit de faciès.” (Pasquier, 1999)
Elle mentionne de la “paranoïa”,un “problème de sécurité” tout en mobilisant un vocabulaire proche d’associer le groupe à un coup militaire puis déboute leurs revendications en se moquant de leurs slogans. Son soutien à Elula Perrin est d’autant plus important à souligner que cette dernière publie également des romans dans lesquels les femmes racisées sont éxotisées et fétichisées dans un parfait exemple de littérature orientaliste, et alors qu’elle se fait ouvertement apologiste du colonialisme (Blase, 2019). Par la suite, le Groupe du 6 Novembre adresse une lettre de réponse à faire paraître au sein de Lesbia que Jacqueline Pasquier refuse de publier. Qu’à cela ne tienne, elles publient par leurs propres moyens. Les travaux du Groupe vont notamment critiquer l’hypocrisie de Lesbia qui dénonce les oppressions subies par les femmes dans les anciennes colonies françaises, mais refusent de faire face aux oppressions raciales au sein de leur propre milieu et la manière dont elles y participent. Lesbia Magazine est loin de représenter toutes les lesbiennes, il représente surtout le vécu et les besoins de la lesbienne en position majoritaire et, ce faisant, révèle les privilèges dont elle jouit et les rapports de dominations qu’elle travaille à maintenir.
Conclusion
S’intéresser à des médias marginaux, minoritaires, à destination de publics invisibilisés dans la presse mainstream c’est avoir accès à une forme de représentation et de discours de soi présent nulle part ailleurs. C’est pouvoir interroger le processus de construction communautaire, mais aussi identitaire. Leur rôle doit être d’autant plus ré-évalué qu’ils sont bien souvent, comme c’est le cas de Lesbia Magazine, des producteurs de discours à l’égard d’un public qui ne possède aucune autre alternative. J’ai ainsi tenté de démontrer de quelle manière Lesbia Magazine illustre, mais aussi participe à la création d’un sujet politique lesbien profondément ancré dans la blanchité. Non seulement l’absence de problématisation de l’expérience raciale travaille à la construction d’un sujet lesbien sans race et par conséquent, de manière pernicieuse, blanc. Gloria Anzaldua déclare notamment « When a ‘lesbian’ names me the same as her she subsumes me under her category. I am of her group but not as an equal, not as a whole person – my color erased, my class ignored[8]» (2009, p.163). Le mensuel, supposé s’inscrire dans une histoire transnationale, propose au contraire un modèle uniforme et finalement restrictif. Tandis que le positionnement de la direction sur les questions raciales et postcoloniales contredit la volonté des rédactrices de s’adresser à « toutes les lesbiennes » et participe à la décrédibilisation et la délégitimation des vécues des femmes racisées. Ces violences sont dénoncées par des collectifs comme le Groupe du 6 Novembre ou encore LOCs Lesbiennes of colours dont les actions d’autonomisation sont à réinscrire dans l’histoire du mouvement lesbien français.
Bibliographie
Almeida, J. (2015). Étude de contenu de la presse lesbienne : Lesbia Magazine de 1989 à 2012 ; (mémoire), [En ligne] URL : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01199375
Blase A. Provitola (2019): In visibilities: the Groupe du 6 novembre and the production of liberal lesbian identity in contemporary France, Modern & Contemporary France
Bonnet, M.-J. (1998). “De l’émancipation amoureuse des femmes dans la cité. Lesbiennes et féministes au XXe siècle”, Les Temps Modernes, 598 mars-avril 1998, p.85-112.
Bonnet, M.-J. (1997). « L’égalité entre hommes et femmes: point aveugle du mouvement gay ? », dans Ex Aequo n° 3, janvier 1997.
Ciasullo, A. M. (2001). Making Her (In)Visible: Cultural Representations of Lesbianism and the Lesbian Body in the 1990s. Feminist Studies, 27(3), 577- 608.
Doumia, N. (2001). “Le Groupe du 6 novembre, Notre Standing Up !” dans Warriors/Guerrières, edité pas le Groupe du 6 novembre, 10–18. Paris: Nomades’Langues Éditions.
Eribon, D. (2012). Réflexions sur la question gay, Paris, Flammarion.
Goyette E. (2014). « L’invisibilite lesbienne dans la sphère publique (mediatique) : pratiques et enjeux d’un identite proto-politique » ; (mémoire), [En ligne] URL : https://www.commposite.org/index.php/revue/article/view/195/162
Groupe du 6 novembre, ed. 2001. Warriors/Guerrières. Paris: Nomades Langues Éditions.
Jacquemart, A. (2011). Les hommes dans les mouvements féministes (1870-2010). Sociologie d’une engagement improbable. (Thèse), [En ligne] URL : https://theses.hal.science/tel-00608896
Jouve, C. (1983). « Médias lesbiens et lesbiennes dans les medias », Lesbia, n°6.
- (1986). « Les dessous de Lesbia », Lesbia, n°35.
Laroche, M. ; Larrouy, M. (2009) Archives, recherches et cultures lesbiennes, 2009, Mouvements de presse : années 1970 à nos jours, luttes féministes et lesbiennes, Paris, ARCL.
Tuck, E. (2009). Suspending Damage A Letter to Communities. Harvard Educational Review
79, 3 : 409-427.
Lesselier, C. (1990) « Lesbianisme, quelle subversivité ? », Lesbia Magazine, n°89, décembre. Pasquier, J. (conference) : 1967-2008 : la presse gay et lesbienne, Jacqueline PASQUIER, Helène de MONFERRAND, Renan BENYAMINA, 17 mai 2008, [En ligne], URL : https://www.bm-lyon.fr/spip.php ? page=video_resultat_recherche.
- (1999). “Au fil du XXIe festival.” Lesbia Magazine, no. 33: p.33- 34. Décembre.
[1] À savoir : décembre 1982 à décembre 1983, soit la première année de diffusion, de décembre 1989 à décembre 1990, de 1994 à 1995, de 2000 à 2001 et enfin de 2008 à 2009. J’ai également pris en compte l’année 2012, soit l’année d’arrêt du mensuel durant laquelle seuls les six mois ont été publiés. La première année de parution me permet d’évaluer pourquoi et comment un tel magazine a pu voir le jour, quels étaient les objectifs de ses créatrices, les premières décisions qui ont été prises ainsi que les premières erreurs. L’année 1990 marque un changement important au niveau de la direction (l’arrivée de Catherine Gonnard) et une évolution de l’édition : Lesbia devient Lesbia Magazine et change de logo ainsi que de format. 1995 représente une période de succès pour la revue dont les ventes ne cessent d’augmenter, mais il s’agit aussi de l’année du départ de Catherine Gonnard suite à de grands clivages au sein de l’équipe éditoriale. C’est une année que je considère comme le pic de la revue avant son déclin. L’année 2000 marque l’arrivée de la couleur et change encore une fois de logo ainsi que de design. Le périodique arbore désormais sur sa couverture le LM retenu par ses lectrices. De plus, Jacqueline Pasquier devient la directrice de la revue et c’est elle qui restera le plus longtemps à ce poste. Enfin, les productions de 2009 m’ont permis d’étudier une année complète du magazine dans une forme récente, alors que la publication peine à garder son lectorat. La chute est confirmée en 2012 avec la publication des six derniers numéros.
[2] Catherine GONNARD (interview), archives personnelles.
[3] Anonyme.« Letters », Lesbia, n°2, janvier 1983, p.2.
[4] Les débuts du féminisme, en tant que mouvement structuré, datent de la fin du 19e siècle (Jacquemart, 2011). À cette époque la lutte est menée dans la mixité, à tel point que l’on parle du “père du féminisme français” en la personne de Léon Richer#. Néanmoins des critiques s’élèvent contre la prédominance masculine dans les postes décisionnaires des associations. En réaction, les femmes mettent en place des mesures restrictives à la participation des hommes, tandis que des associations non-mixtes voient le jour. Pour autant, l’émergence d’associations non-mixtes ou encore l’organisation d’assemblées réservées aux femmes sont sujets à débat. Pour certaines, l’exclusion des hommes priverait les mouvements de ressources et de moyens conséquents.
[5] Auteure inconnue, « Mixité/non mixité l’éternel debat », Lesbia, n°289, avril 2009, p.20-22.
[6] Michèle LARROUY dans Martine LAROCHE, Michèle LARROUY, ARCL, Catalogue des Archives Lesbiennes de Paris, Mouvements de presse des années 1970 à nos jours, luttes féministes et lesbiennes, Paris, ARCL, 2009, p. 185
[7] Et même dans ces conditions, le sujet fait débat sur la place ou non de ces thèmes dans la revue.
[8] (traduction libre) : Lorsqu’une « lesbienne » me donne le même nom qu’elle, elle me fait entrer dans sa catégorie. Je fais partie de son groupe, mais pas en tant qu’égale, pas en tant que personne à part entière – ma couleur est effacée, ma classe sociale est ignorée… »